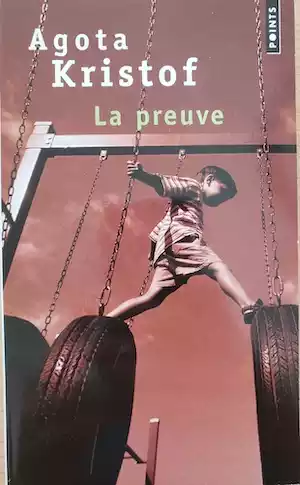La Preuve
Lecture Osiris
Marie-Noëlle Riboni-Edme a publié une judicieuse étude sur « la trilogie des jumeaux » d’Agota Kristof ». Elle nous a autorisé à en publier l’introduction, ci-dessous :
Ce n’est pas dans une langue maternelle, douce et enveloppante, mais dans « une langue ennemie », comme elle le dit dans son dernier ouvrage, L’Analphabète, qu’Agota Kristof a pris le risque du roman. « Au début, dit-elle encore, il n’y avait qu’une seule langue. Les objets, les choses, les sentiments, les couleurs, les rêves, les lettres, les livres, les journaux, étaient cette langue » . A la lecture de ce chapitre intitulé « Langue maternelle et langues ennemies », on comprend que l’émergence d’une autre langue ne peut être que le résultat d’« une lutte longue et acharnée » . De ce conflit, Agota Kristof sort victorieuse, en tout cas du point de vue du lecteur. Cette langue ennemie, la nôtre, elle l’a conquise et a construit avec elle un univers implacable aux formes rigoureusement dessinées.
Le Grand Cahier (1986), La Preuve (1988) et Le Troisième Mensonge (1991), agencés en trilogie, évoquent d’abord, fût-ce de loin, la tragédie. C’est, en effet, la première définition que donne le dictionnaire du mot « trilogie » : ensemble de trois tragédies sur un même thème. Ce thème, chez Agota Kristof, c’est l’exil sous diverses formes : l’exil du monde de l’enfance dans Le Grand Cahier, l’exil vers l’étranger dans La Preuve, l’exil dans son propre pays dans Le Troisième Mensonge. En outre, ainsi que dans la tragédie, chacun des trois romans plonge dans un monde opaque où aucune solution n’est proposée : les problèmes posés n’ont pas de réponse ; les énigmes restent à déchiffrer. L’objectif, en effet, n’est pas de résoudre les problèmes, mais bien seulement d’en montrer la complexité, et c’est là tout l’enjeu de cette création romanesque.
Agota Kristof est née en Hongrie où elle a vécu ses vingt premières années, entre 1935 et 1956. Elle a connu les effets de l’idéologie totalitaire dans son pays sous domination soviétique. Les traces n’en sont pas anecdotiques : l’emprise du régime totalitaire sur l’individu, les transformations profondes qu’il opère dans l’appréhension du monde sont présentes dans la texture de la trilogie. Car le totalitarisme induit un rapport particulier au langage. Comme le dit Hélène Vexliard , « il mène une véritable offensive sur la pensée et les affects, une sorte de lavage de cerveau qui cherche à imposer des fictions comme réelles, et inversement à faire croire que ce qui arrive réellement est un rêve. »
Écrire une fiction, c’est, en l’occurrence, être au cœur du problème, au cœur de l’interrogation que pose la fiction dans son rapport à la réalité et à la vérité, interrogation particulièrement vive lorsque le mensonge est le discours dominant.
Le mode d’écriture d’Agota Kristof pose la question de la littérature de façon cruciale. Son itinéraire personnel l’a coupée de ses racines ; son itinéraire littéraire en a exploré les conséquences. Dans la trilogie, la fracture est violente et multiforme : fracture due à la cruauté de la guerre, à la terreur dictatoriale et à leurs effets de déshumanisation ; fracture due à l’exil, aussi bien géographique que linguistique ; fracture qui atteint le langage, donnant naissance à un double jeu dans lequel on ne distingue plus la vérité du mensonge ; fractures qui finissent par produire une division telle que seul le travail de l’écrivain peut en modeler les formes pour tenter de créer du sens.
Par leurs titres, les trois romans orientent d’emblée dans ces directions : Le Grand Cahier évoque la chose écrite, La Preuve introduit un soupçon que confirme Le Troisième Mensonge. La lecture linéaire du premier volume est aisée et sans heurt – si ce n’est que le monde décrit est à la limite du supportable par sa cruauté – et cette facilité de lecture – avec la même restriction – se poursuit dans le second volume jusqu’au « Procès-Verbal des autorités de la ville » qui clôt le récit. Ces trois dernières pages agressent brutalement le lecteur et bousculent ses certitudes. Il peut encore, à ce point de l’histoire, se réfugier derrière la constatation que s’exprime là un discours d’autorité. Mais le dernier roman lui emboîte le pas par la voix du narrateur lui-même qui met en pièces tout ce qui précède. Le lecteur est alors contraint de reconsidérer l’ensemble, de mesurer ce qui a basculé. Mais où prendre appui puisque les mots se contredisent ? Précisément dans la contradiction et dans le singulier rapport au langage qu’elle met en place. On imagine aisément l’instabilité d’un appui de cette nature et le caractère périlleux d’une progression qui découvre, à chaque étape, une nouvelle forme de la contradiction.
A cause de ce rapport particulier au langage, rendu d’autant plus aigu qu’il est mis au service de la composition d’une fiction, l’œuvre d’Agota Kristof s’inscrit entièrement dans le questionnement actuel sur la littérature. Son écriture évoque parfois Kafka, parfois l’écriture blanche d’Albert Camus ou d’Annie Ernaux, parfois encore le Nouveau Roman. Elle a partie liée avec l’expérience singulière du langage lorsqu’il contient sa propre remise en question et lorsqu’il devient parole littéraire. Cet enjeu, l’un des plus importants de son œuvre, se formule à travers les personnages principaux des trois romans qui tous sont écrivains et mettent en perspective, dans leurs fictions, la création fictionnelle.
Par les caractéristiques qui viennent d’être présentées, la réflexion que propose cette œuvre ne se limite pas, en effet, aux pays dont le régime est explicitement totalitaire. Elle concerne le monde contemporain, régi, dans maints endroits, et pas seulement dans le champ politique, par des formes d’autorité insidieuses, si l’on définit l’autorité totalitaire comme la voix de l’autre lorsque s’y adjoint le pouvoir – sous quelque forme que ce soit – et que le débat n’est pas autorisé. Elle concerne encore la domination que le langage peut exercer sur l’individu. Ne sommes-nous pas tous, en effet, en exil dans la langue, dans une langue d’exil à conquérir, propulsés dans un univers de mots qu’il faut faire coïncider avec la réalité, propulsés dans un discours construit par d’autres, auquel il faut confronter le sien propre ?
Très courte, l’œuvre d’Agota Kristof est extrêmement dense ; composée dans une langue très simple, elle est extrêmement résistante. C’est à cette résistance que nous prétendons nous mesurer en déployant le texte. Nous formons l’hypothèse qu’il détient les termes des questions qu’il pose et les réponses à ces questions. C’est pourquoi nous ne recourrons qu’à lui-même. Il ne s’agit pas de dire « le » sens vrai du texte, en dehors duquel il n’y aurait plus de sens. Il s’agit de mettre en valeur, par l’observation et l’interprétation du jeu des formes, la spécificité de ce texte, de repérer les éléments signifiants et d’en montrer les interactions. Si l’on tient, comme le dit Julia Kristeva , reprenant une intuition de Mallarmé , que « la pratique littéraire se révèle comme exploration et découverte des possibilités du langage », il nous appartient de mettre au jour l’architecture singulière que le langage construit dans la trilogie. Nous conduirons cette lecture à la lumière de la réflexion que mène la critique sur la poétique du récit et particulièrement sur le roman, à la lumière aussi de la pensée contemporaine et de son appréhension du langage. D’autres soutiens seront sollicités auprès de pensées et de concepts extérieurs à l’œuvre, parce qu’ils apportent un éclairage sur l’idéologie totalitaire – ainsi Hannah Arendt – ou qu’ils permettent de se dégager de la représentation binaire et simplificatrice d’un rapport de pouvoir dans lequel la littérature n’accepte pas d’être enfermée – ainsi Gilles Deleuze et Félix Guattari.
Nous explorerons cet univers en sept étapes qui s’efforceront de lever un à un les voiles, des plus transparents aux plus opaques. Le premier chapitre effectuera des repérages dans l’histoire personnelle d’Agota Kristof, dans l’histoire des romans, mais aussi dans l’histoire officielle. Le chapitre suivant montrera comment l’écriture naît et se nourrit de la fracture produite par la collision violente entre la grande histoire et la petite. Le troisième chapitre s’arrêtera sur la division d’un monde partagé entre la nostalgie de l’ancien et l’adaptation obligée au nouveau. Pour réaliser cette adaptation, le sujet, lui aussi divisé, s’invente un double par l’intermédiaire du « nous », marque paradoxale de l’absenceprésence, symbole complexe de l’unité et de la division : cette construction sera l’objet du quatrième chapitre. Essentiellement contradictoire, la pensée qui traverse la trilogie crée un espace-temps qui lui est propre. Sa forme labyrinthique sera explorée dans une cinquième partie, afin d’en proposer une topographie. Nous accèderons ensuite aux souterrains, habités par le mensonge, qui résonnent de voix antagonistes, voix qui construisent le paradoxe sur lequel repose l’édifice. La dernière étape concernera le lecteur. Sa place est, en effet, ici, fondamentale, car il peut, soit se trouver pris dans un piège dont il ne parvient pas à sortir et devenir la proie du texte, prisonnier du labyrinthe que celui-ci construit, soit s’associer avec l’auteur pour faire du langage poétique un organisme vivant et donner à la littérature toute sa force d’impact.
Agota Kristof a fait le choix d’une autre langue afin de « mettre une distance entre [ses] terreurs et [son] écriture » . Mais, si la langue l’a éloignée provisoirement de ses terreurs, elle ne l’a pas débarrassée de ce que l’idéologie totalitaire a imprimé en elle. Écrire la division, c’est habiter la déchirure, habiter tout à la fois un dehors et un dedans, un passé et un présent. C’est retrouver sa propre prison dans un pays libre. C’est accepter de ne rien écarter, de ne rien résoudre. C’est explorer le langage aussi loin que possible, même dans son mensonge. C’est n’être chez soi que dans cette écriture.
« La trilogie d’Agota Kristof – Écrire la division » de Marie-Noëlle Riboni-Edme, Ed. L’Harmattan, collection Critiques Littéraires, 2007, 230 pages.
Les ouvrages et documents peuvent être consultables sur place, notamment lors des formations. Pour toute demande d’informations sur cette référence, merci de nous contacter à ressources@centreosiris.org.