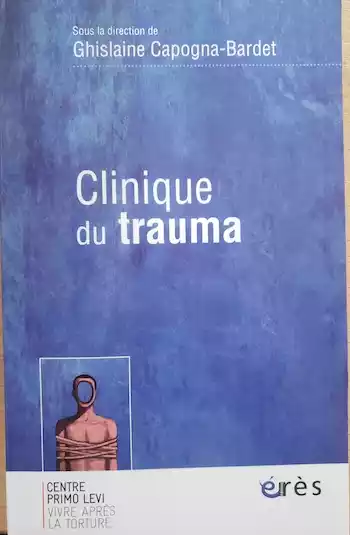Clinique du trauma
Lecture Osiris
L’accueil des personnes souffrant des conséquences des violences qu’elles ont subi nous met en contact avec des signaux de détresse qui s’aggravent avec les conséquences de leur situation concrète passée et actuelle. Le premier mouvement est de soutenir un psychisme blessé et de considérer que le soutien apporté dans la réalité du moment doit être lié à la perspective d’un travail psychique qui à son terme surmonterait les blessures. Dans cet ouvrage collectif rassemblé par Ghislaine Capogna-Bardet, la question abordée est celle de la place respective occupée par la structure qui a fondé le psychisme d’un sujet et celle que vient prendre le réel traumatique.
L’effroi traumatique fait effraction dans le psychisme mais rencontre, selon Reik, les appréhensions anciennes en rapport avec l’angoisse de castration, cela se trouve-t-il conforté par la clinique ? Dans sa contribution, Helena d’Helia propose que « en convoquant quelque chose de pulsionnel dans la relation transférentielle que le sujet pourra humaniser l’événement et renouer affect et expérience vécue, nécessaire à une inscription psychique » jusque là le sujet se trouve pris et habité par quelque chose d’étrange, une altérité absolue. Aurélia Malhou, juriste au Centre Primo Levi questionne ce qui est demandé et opposé au demandeur d’asile, documents, preuves, éléments qu’il a dû abandonner dans sa fuite. Le rapport à la vérité est de même invoqué par les membres de l’OFPRA, de la CNDA qui n’ont au final le plus souvent que leur intime conviction pour prendre leur décision. Quelle place laisse-t-on à des demandeurs d’asile qui reconnus comme tels peuvent entreprendre une nouvelle existence ( avec de nouvelles épreuves) ou qui rejetés se voient renvoyés vers le risque de la mort dans leur pays.
Solal Rabinovitch soumet à ces questions le cas d’une analysante dont le psychisme est envahi par des hallucinations et des idées délirantes par suite du surgissement d’un trauma dont le réel concerne les actes incestueux de son père à son égard et la rencontre avec un enfant « fou » fait « resurgir le chaos des émotions et des affects de l’enfant qu’elle fut, enfant non sauvé ». Penser le trauma est quasi impossible et l’écran du fantasme vient à vaciller, confronté à l’excès d’excitation sexuelle. Mais dit Solal Rabinovitch ce versement
dans l’hallucination et le délire n’est pas d’ordre psychotique mais témoigne du bouleversement narcissique. Référence faite à Ferenczi, la tentative de venir à bout du traumatisme passe par la falsification pour rendre l’événement acceptable grâce au clivage.
Alice Cherki propose une réflexion sur le silence des victimes ( mais aussi des bourreaux) dans la suite des périodes de « cataclysme », silence qui néanmoins s’accompagne de comportement violent (dans une autre étude sur la résilience, Serge Tisseron – La résilience – Que sais-je – PUF 2007, s’interroge sur la « réussite » pour le sujet et les autres de ce type de résilience). Il s’agit là bien plus d’un clivage, et les personnes traumatisées « n’ont pas les mots pour le dire, … la chaîne signifiante du sujet est rompue, et les traces sont expulsées… » « Les descendants héritent d’un secret encrypté » P. 54 Chez ces descendants, « enfants de l’actuel », la honte (et non la culpabilité) vient s’installer, « une exclusion de soi à soi, corps étranger à sa propre représentation ». Pour que l’accès à la représentation et au discours soit possible, un lien de transfert est nécessaire mais au moyen d’un espace de médiation, un lieu « métaphoriseur » qu’Alice Cherki ne résume pas à l’espace du lien psychanalytique mais étend celui-là à un ensemble de systèmes symboliques à rechercher dans le droit, le politique, l’économique, le culturel, l’histoire mais aussi le religieux. Encore faut-il que ces références donnent accès à des représentations qui permettent l’élaboration du traumatisme sinon le mécanisme de déni ne cessera de provoquer le discrédit de l’Autre et de conduire à des passages à l’acte. La reviviscence des scènes et des sensations traumatiques est souvent très intense,
Bertrand PIRET examine cet élément clinique en tant que rêve ou hallucination. D’ordinaire, le rêveur même ayant vécu un sentiment d’étrangeté va rapidement faire la part entre réalité et onirisme. L’anthropologie ouvre à la compréhension de la place importante du rêve dans diverses cultures eu égard à son rapport avec la vie du groupe. Avec Freud, B. Piret reprend l’hypothèse de l’accomplissement du désir mais il faut prendre en compte la compulsion de répétition, ainsi le partage entre la répétition traumatique et les reviviscences hallucinatoires reste encore à préciser. Le trauma viendrait comme un corps étranger, sans liaison possible, l’hallucination correspond bien plus à une « présentation » qu’à une représentation, à partir d’une observation, B. Piret fait l’hypothèse d’un lien entre l’hallucination et la culpabilité, le délire assurant une fonction défensive, grâce à la pensée magique dans la culture, il permet l’affrontement des parties malveillantes et les réponses protectrices. Le retour à la culture renoue les liens sociaux, mais il devient inopérant lorsque cette société a laissé se répandre la violence (devenue habituelle) et ses monstruosités, désagrégeant ces liens.
Patricia Janody définit le trauma psychique comme un « trou causé simultanément dans le corps et la langue qui fait rupture avec les modes d’expression antérieurs du sujet ». Ce silence est troublé par des symptômes qui ne peuvent être réduits ou interprétés, et qui interroge la possibilité d’un espace clinique. Par le cas clinique d’une patiente, mère d’un jeune enfant, menacée dans un délire, P. Janody montre l’importance d’une réponse très concrète (fourniture de lait) à l’irruption d’une condition sans issue.
Marie-Ange Baudot-Gérard s’appuie sur le travail de Freud au sujet de la compulsion de répétition qui vient mettre en échec le principe du plaisir. Il y a un trauma intrinsèque à l’être de parole, le parlêtre ( Lacan) chez lequel il inaugure la structuration du symbolique dans le réel. « Le sexuel… permet d’associer au lieu de la détresse les tendances masochistes et l’aspiration à la mort » p.103 Pour le sujet se succèdent le traumatisme de la naissance jusqu’à la fin de la prématuration physiologique et dans le traumatisme du sevrage. La répétition est la seule tentative d’inscription possible. C’est dans le transfert que se trouve la possibilité de lier les éléments désorganisés. Il est de nouveau souligné que les effets du traumatisme infligé à un individu détruit les capacités de penser et de parler. Le harcèlement en entreprise est analysé sous cet angle. Mais il convient de laisser le temps au sujet de se voir soulagé de sa sidération protectrice, au besoin avec le réel d’un psychotrope, d’un appui par son entourage, par la suite les mots traverseront le corps et viendront traduire les impressions et les sensations éprouvées.
Hervé Bentata parle de la clinique de femmes venues se réfugier en France, fuyant des situations de guerre civile, avec leur bébé et qui rencontrent le plus souvent un accueil peu enthousiaste. Il pose très rapidement la question du cadre clinique et de la pratique psychanalytique en regard de ces personnes auxquelles la neutralité bienveillante ne suffit pas compte tenu de leurs conditions sociales, il nomme ainsi la « clinique de l’extrême ». Il est question aussi de la « santé du clinicien », de la nécessité de l’engagement citoyen et la répétition « quasi » infernale des ces histoires de violences traumatiques, de même que de leurs effets transgénérationnels. Hervé Bentata interroge aussi la nature particulière de ce type d’exposé dont les effets de jouissance chez l’auteur et le lecteur ne sont pas négligeables.
Assumpta Mugiraneza la langue rwandaise permet d’exprimer et de nommer très précisément. Cette langue a été gravement « blessée » dans le temps du génocide, elle était celle des tueurs. L’expression du deuil se heurte à la dégradation du sens de la langue. Alors apparaissent des litotes ce qui efface la symbolisation. Pendant le génocide tuer se disait : « travailler », et les objets utilisés ne pouvait être nommés sans faire surgir l’abomination. Ainsi la langue s’est appauvrie. Et cela a eu une incidence sur les rapports d’enquêtes. De plus, nombre de documents ont été détruits et les victimes ont dû raconter encore et encore. Les bourreaux biaisent avec le langage pour se soustraire à ce qui est injustifiable. Et le langage poétique est alors convoqué, des chansons sont composées, mais des personnes tel le Président de l’association Ibuka (souviens-toi) voudraient entendre des paroles qui feraient croire à un dépassement des traumatismes. Le langage a recours à un voile qui répare : « Donc c’est une recréation de quelque chose d’acceptable, de pudique, entre les morts et les vivants. » Assumpta Mugiraneza a fondé un Centre pour le patrimoine (IRIBA) pour oser le regard vers l’arrière et comprendre l’arrivée du génocide dans la société rwandaise au moyen des sons et des images.
Omar Guerrero interroge la différence de statut de la personne traumatisée selon l’origine de la violence subie, un sujet victime d’une catastrophe, d’un accident, peut considérer que même si cela fait rupture dans son existence il persiste un rapport symbolique partagé par le groupe humain auquel il est lié. Dans le cas d’une violence administrée par un semblable, les repères symboliques sont désorganisés. Le schéma L qu’a apporté Lacan dépasse la simple communication pour montrer que le sujet passe par des représentations dans sa tentative de s’adresser à un Autre et dans la situation de traumatisme politique : « l’innommable est devenu possible, la dégradation atteint toutes les formes d’organisation symbolique, de la famille et du lien social, jusqu’au langage ». Omar Guerrero recours ensuite à la formule du fantasme proposée par Lacan ($♦α) pour aborder le rapport du sujet à l’autre et décrire ce qui peut se produire dans la rencontre entre le bourreau et sa victime, dans la mesure où celle-ci va être dans un mouvement de captation qui le dépossède de sa condition de sujet et le plonge dans la confusion ou dans un état proche de la psychose, ce que la clinique nous montre assez souvent. Enfin, il décrit par deux cas cliniques comment le « voilement » dans la parole permet à ces patients de retrouver l’accès à ce qu’ils ont été avant l’effraction de leur psychisme.
Marcelo Viñar, ce psychanalyste uruguayen a connu la dictature dans son pays, il interroge en quoi l’horreur de la violence peut fasciner et comment l’être humain, par suggestibilité, peut devenir l’acteur de cette violence sans en éprouver la moindre culpabilité, se soumettant à une loi odieuse qui étreint tout le groupe humain. Il dit aussi que le clivage entre les indemnes et affectés par la terreur se prolonge longtemps dans la société et reste source de ressentiments. Le dépassement de cela ne peut se faire sans que des idéaux communs puissent à nouveau se construire.
Eric Sandlarz psychanalyste au Centre Primo Levi développe la conceptualisation du traumatisme par une lecture du développement de la pensée de Freud. Il souligne que les traumatismes « sont toujours une mise à l’épreuve de la consistance narcissique du sujet et de l’ensemble de ses repères identificatoires » il termine son propos ainsi : « Quand la terreur gangrène tous les liens sociaux, quand l’autre est synonyme d’inquiétant, le collectif où s’originent les sujets ne cesse de tramer des symptomatologies psychotiques ».
Olivier Douville, psychanalyste, nous parle des enfants soldats et du processus qui conduit à leurs actes, l’enrôlement détruit toute l’humanisation façonnée par les rituels d’initiation propres à ce qui structurait la société, s’il résiste, il est sacrifié. La clinique des enfants soldats est celle d’un mode particulier d’amnésie qui n’est pas l’effet du refoulement oedipien.
Ils sont soumis à des chefs qui vont jusqu’à ordonner des meurtres apparemment sans raison. Mais les morts vite oubliés insistent dans la vie psychique, ces jeunes se vivent après la guerre comme exclus de la communauté des vivants. Le soin doit passer alors par l’inscription du sujet dans la communauté au sens anthropologique qui leur permet de lire leur ascendance, leurs alliances dans le respect des morts. Catherine Pinzuti nous invite à la lecture de deux livres autobiographiques, celui de Berthe Kayitesi, où elle se penche sur le massacre de ses parents au Rwanda, et celui de Rithy Panh et Christophe Bataille, l’Élimination, vécu au Cambodge.
Laurent Gaudé, écrivain, met en regard deux textes, l’un est une fiction, c’est le roman « Où j’ai laissé mon âme » écrit par Jérôme Ferrari, l’autre un guide pratique sur la conduite d’interrogatoires (y compris la torture) à l’intention des agents de la CIA. La fiction est plus proche de la vérité, et l’on y voit deux militaires opposés dans leurs valeurs mais où le plus humaniste s’enfonce dans le naufrage des valeurs. Quant à « Kubark », la langue y est lisse et pseudoscientifique, elle cache ce qu’elle a à dire.
Les ouvrages et documents peuvent être consultables sur place, notamment lors des formations. Pour toute demande d’informations sur cette référence, merci de nous contacter à ressources@centreosiris.org.